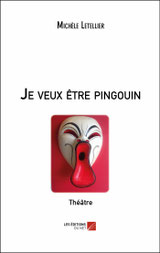Michèle LETELLIER, son blog: séquences-vie d'une scénariste
Annie GIRARDOT
Il y a cinq ans, Annie, ce 4 mars 2011,
nous t’accompagnions, le cœur lourd, pour ta dernière représentation
en l’église St Roch.
A l’extérieur, la rue était pleine de tes admirateurs qui, au fil des années,
dans tes hauts comme dans tes bas, ne t’avaient jamais lâchée.
Au milieu de la nef, tu étais là, invisible mais si présente, entourée de tant de noms connus ou inconnus qui traversèrent ta vie, de femme ou de comédienne. Ce matin-là, tu jouais à guichet fermé. Plus aucun strapontin de libre.
Alain Delon eut des mots tendres pour toi, en français et en italien,
et t'a joliment dit ton poème préféré de Prévert
« Pour faire le portrait d’un oiseau ».
Claude Lelouch réussit à nous faire rire, t’imaginant déjà en train de tourner, là-haut, avec le « Grand Metteur en Scène », demandant, pour la peine, une standing ovation.
Et ce furent bien les premières obsèques (j’ai hélas assisté à beaucoup dans cette paroisse des artistes) où je vis la « salle » entière se lever pendant la cérémonie et applaudir longuement le cercueil, coutume réservée plutôt à la sortie de l’église.
C’était touchant, drôle, poignant, à ton image, toi qui savais si bien nous faire passer des rires aux larmes, à la scène comme à la ville.
Je fixais ton cercueil, et je pensais à Madame Marguerite-toi demandant à ses élèves de décrire dans une rédaction leur propre enterrement – et si j’en prends un qui copie sur l’enterrement du voisin, c’est zéro pour tous les deux! - , je pensais à l’enterrement façon cirque d’Emma Lambert-toi, séquence que j’avais écrite vingt ans plus tôt,
mais, cette fois-ci, c’était « pour de vrai ».
Où étais-tu en ce moment d’hommage ? Flottant au-dessus de nous sous les voûtes ? Enfin libérée de ce corps devenu prison douloureuse ? Ou définitivement enfermée entre ces planches, toi, la femme libre qui les avais tant aimées, tant parcourues.
Tout me revenait en vrac.
Notre fou-rire chez un producteur, notre complicité sur le tournage, tes doutes permanents, tes refus, tes coups de gueule, les bonnes bouffes au resto ou chez moi, les représentations de Madame Marguerite de 1974, celle de 2002,
ta chaleur vis-à-vis des gens qui faisaient la queue pour un autographe, le temps que tu passais à écouter leurs petites histoires, cet amour des autres que tu prodiguais et que tu recherchais toujours éperdument dans tes rencontres professionnelles, amicales ou amoureuses.
Tu donnais tout, cash, sans retenue, à la vie, à tes hommes,
à tes personnages.
Pour moi, tu resteras
LA GIRARDOT,
la généreuse, la talentueuse, la vie.

Eté 1994. Je viens d’arriver en voiture de Paris dans ce coin perdu et magnifique de montagne, du côté de Briançon. Heureusement, je connais la région et le plan de tournage. Au détour d’un virage, en pleine forêt, l’équipe s’active. Un assistant me fait signe : on ne passe pas. Je stoppe ma voiture, en sors, ne claque pas la portière, le clap va être demandé, je me cale contre un arbre, me fais petite. « Silence… Moteur demandé » crie le metteur en scène, un peu plus haut. On n’entend plus que le craquement léger des bois, le chant d’un oiseau. Les techniciens, image, son, maquillage, script sont en place. Aucun ne me connaît. Me prenant pour une touriste, l’assistant me fait signe de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit. « Ça tourne… Action ! ». A quelques mètres, arrivant du bas de la vallée, deux vieilles dames aux cheveux blancs apparaissent. Elles montent vers le village à travers la forêt.
Justine (Catherine Samie) : « Ta lettre disait : viens, j’ai besoin de toi. Je suis là, Emilie. »
Emilie (Annie Girardot) : « On croit l’avoir apprivoisée, la camarde. Pourtant, quand elle vous tombe dessus… »
Justine : « Tu veux dire… »
Emilie : « Le toubib a été clair : cancer. Si vous avez des papiers à mettre en ordre… Des papiers… Toute une vie, quoi ! »
La séquence se poursuit. Ce sont mes mots. Je les ai écrits, je les connais par cœur. Mais, ces mots, dans la bouche d’Annie Girardot, me donnent la chair de poule, me mettent les larmes aux yeux. Comme à toute l’équipe. « Coupez ». Je n’ai pas bougé de mon arbre, envahie par l’émotion, quand, soudain, Annie me repère et me crie, faisant retourner tout le monde vers moi : « Tu sais quoi, toi, là-bas ?…Tu devrais faire « auteur » dans la vie ! ».
Elle vient de me présenter à toute l’équipe de tournage. Avec classe et générosité.

Ecrire pour La Girardot, quel scénariste n’en avait rêvé ?
Avec Robert Hirsch et Suzanne Flon, Annie Girardot faisait partie, depuis l’enfance, de mon Panthéon personnel, de ceux qui m’avaient donné envie de faire ce métier, et que j’admirais tant. J’ai eu la chance d’écrire pour les deux dernières, et de partager avec elles des moments forts d’amitié.

1974. Je venais d’entrer au Cours Simon quand Annie Girardot créa Madame Marguerite. Ce fut le choc. Quelle leçon pour l’apprentie comédienne que j’étais. Je l’ai vue une trentaine de fois. Dès que je le pouvais, je filais au théâtre Montparnasse, je prenais la place la moins chère, tout en haut, en semaine, et, les soirs où j’avais repéré une place vide plus bas, plus près de la scène, vite je descendais quand les portes se refermaient, et je m’y glissais discrètement, alors que le noir se faisait dans la salle. Je prenais là un vrai cours de théâtre en live : liberté du ton, du corps, maîtrise du personnage, de la voix, des émotions, relation aux spectateurs devenus, malgré eux, les élèves de cette prof. sidérante, provocante, névrosée, délirante, émouvante, attendrissante, pleine de vie, pleine de la Vie. La Girardot, quoi ! Pour moi, elle est née là. Il n’est pas étonnant qu’elle ait trimballée Madame Marguerite dans le monde entier, pendant trente ans, jusqu’à ses dernières forces.
Théâtre, films, je ne ratais rien de sa carrière, mais je n’aurais jamais imaginé écrire un jour pour elle. Devenue scénariste, je n’osais encore y penser quand la rencontre s'annonça pour la première fois, en 1989.

Les auteurs étant à court d’idées pour poursuivre la saga, TF1 vint alors, me chercher. Le directeur de la fiction m’avait repérée sur l’écriture des « Marc et Sophie », dont j’avais écrit quelque 40 épisodes, comédies de 26’. Pour me faire plonger dans l’écriture d’un mélo de 9 épisodes de 90’, eux-mêmes la suite de 8 épisodes où tout avait déjà été inventé, fallait du culot ! Du culot pour me le proposer, du culot pour accepter. J’acceptai de relever le défi.
Avec angoisse –serai-je à la hauteur ?- et enthousiasme – écrire pour Annie Girardot.
Mais, alors que nous travaillions quasiment jour et nuit, avec Gilles Tourman, tricotant, détricotant l’intrigue, la nouvelle tomba : Girardot ne voulait pas faire la suite.
Branle-bas de combat à la production, à la chaîne… Invitations à déjeuner, à dîner, augmentation de son cachet, aménagements de tournage pour elle. Rien n’y fit.
Notre premier rendez-vous était raté.
Nouveau branle-bas de combat à TF1 pour trouver une « remplaçante » ou un « remplaçant » à Annie Girardot. Il nous fallait inventer un nouveau personnage, fort, qui s’insérerait dans une saga où l’on n’avait jamais parlé de lui, et la porterait.
TF1 en folie balançait des noms improbables : Sophia Loren, Mastroianni, Daniel Auteuil… Tout y passait. Pendant ce temps, nous, auteurs, ne savions toujours pas pour qui écrire, quel personnage amener. Et l’on comprendra que ce n’est pas la même chose de créer un personnage pour Sophia Loren ou Daniel Auteuil. Ce fut Annie Cordy.
Il nous restait deux mois avant le début du tournage. Un vrai challenge, dont je reparlerai ici.

Une femme en descend, observe le cortège passer en contre-bas, demande qui on enterre. On lui répond : « Emma Lambert ». A son regard, on comprend qu’elle la connaissait et qu’elle n’arrive pas au village pour rien. « Orages d’été, avis de tempête » était lancé. Annie Cordy le portera formidablement.

Quelques mois plus tard, TF1 m’appelait, me demandant si je pourrais reprendre Sœur Philomène pour Annie Girardot. Je réfléchis, l’idée était bonne, je voyais ce que je pouvais en faire, ce que je devais changer pour adapter le personnage. J’appelai Pierre Barillet qui donna son accord, celui de Grédy. Un dîner fut organisé chez the big boss. Avaient-ils récupéré leur avance ?... Ce n’était pas mon problème. Je ne reverrai, d’ailleurs, jamais le « petit » producteur, disparu de l’organigramme. Cette fois, on avait rendez-vous, en haut d’un immeuble de l’avenue Raymond Poincaré, dans l’appartement du fondateur de cette énorme société de production, gérant différentes filiales. A soixante-dix ans, cet homme grand, élégant, aux cheveux blancs et fournis, était respecté dans l’audiovisuel, où il « pesait lourd ». Je l’avais déjà croisé une ou deux fois, puisque c’est pour sa société de production que j’avais écrit ces 9 épisodes d’ « Orages d’été, avis de tempête » qui avaient fait les beaux soirs et les bons audimats de l’été 1990 sur TF1. Je ne l’avais, toutefois, jamais rencontré vraiment et j’étais un peu intimidée à l’idée de dîner chez lui. Mais, je l’étais encore plus à celle de rencontrer pour la première fois Annie Girardot… Enfin !

Pour l’anecdote, dix ans plus tard, a fleuri sur TF1 une nouvelle série : « Sœur Thérèse.com ». Même chaîne, même production, une bonne sœur héroïne. Avec Dominique Lavanant. Juste une coïncidence...

L’aventure du film, en deux épisodes, « Une soupe aux herbes sauvages », ne fut pas un long fleuve tranquille. Elle s’étala de 1992, signature de mon contrat de scénariste, à 1997, diffusion sur France-Television. Même de fin 1991, quand un producteur, avec qui j’avais déjà travaillé, me donna rendez-vous : « Je viens d’acheter les droits d’un livre. Je crois que c’est pour toi. Lis ça, et dis-moi ce que tu en penses. » Il me tendit « Une soupe aux herbes sauvages » d’Emilie Carles. Je le connaissais par cœur, ce livre. Sinon dans les phrases, du moins dans l’esprit. C’était un livre culte des années 78-80. Publié en 1977, on l’avait découvert, un soir de 1978, à Apostrophes, où une petite mémé rebelle de 78 ans avait fait un tabac. Invitée de dernière minute, suite au désistement d’un auteur, dans une émission dédiée aux « Femmes, femmes, femmes ». Pivot et les spectateurs découvrirent cette montagnarde, née en 1900, qui s’était acharnée, depuis l’enfance, à aller à l’école, contre la volonté de son père, en assumant les travaux des champs, avec ce seul but : devenir institutrice. Elle écrasa toutes les féministes parisiennes qui piaillaient et se coupaient la parole sur le plateau. Son livre rappelait le bon sens, la dureté de la vie dans nos montagnes au début du siècle, sa lutte pour l’accès à l’éducation, à la modernité, son idéal libertaire et pacifiste, son combat écologique aussi, puisque c’était aussi elle qui, à 74 ans, avait déclenché une manifestation de tracteurs à Briançon contre le projet de voie rapide qui devait éventrer sa vallée, la vallée de la Clarée, qui finira par être classée après sa mort. Une sacrée bonne femme qui venait de sortir son premier livre. Best-seller dès le lendemain, traductions à l’étranger. Livre de chevet des instituteurs, des professeurs qui le faisaient découvrir à leurs élèves… Oui, qui ne connaissait pas « Une soupe aux herbes sauvages » ?
Je m’étonnais, d’ailleurs, qu’aucun film n’ait été tiré de ce livre. Le producteur m’expliqua que cela avait failli plusieurs fois, dans les années 80 (Emilie Carles était décédée en 1979, donnant son corps à la Science). Différents producteurs, réalisateurs s’y étaient essayés. Dominique Labourier, Annie Girardot et d’autres comédiennes avaient été pressenties pour jouer Emilie Carles. Mais aucun projet n’aboutit, semblait-il à cause des réticences du fils aîné, et ayant-droit, Georges Carles. « C’est un passage obligé. Il faudra que tu le rencontres. Sur place, à Val des Près. Et qu’il t’accepte. »
Je me replongeai dans le livre, avec un œil professionnel, cette fois. Il y avait bien tout dans la vie d’Emilie Carles, née Allais, pour bâtir un bon scénario. La beauté et la rudesse de la montagne omniprésente, l’énergie de cette petite fille qui s’acharne à aller à l’école, à des kilomètres à pied, même l’hiver dans la neige, après avoir déterré les patates du sol glacé, le père, Joseph, qui se fait braconnier pour faire vivre sa famille, et tous ces drames qui s’accumulent sur sa jeune vie. Un peu too much, aurait dit le producteur, si je les avais inventés. Sa mère foudroyée un été d’orage dans un champ alors qu’elle n’a que quatre ans, son père adoré qui l’envoie chez un oncle qui la terrifie mais lui fait découvrir la lecture, son frère prisonnier, puis porté disparu lors de la première guerre mondiale, et dont elle apprendra qu’il est mort de faim le jour-même de l’armistice, une sœur devenue folle, internée, une autre morte en couche, ses difficultés en tant qu’institutrice à convaincre les paysans d’envoyer leurs enfants à l’école et, après son mariage avec Jean Carles, leur petite fille de 6 ans écrasée devant la maison, au début de la seconde guerre mondiale, par un camion militaire roulant trop vite…

















J’ai le privilège de pouvoir visionner, de temps en temps, « mon » film : celui du tournage, que j’ai filmé avec mon camescope. Un making off personnel où je ne me lasse pas de voir et revoir La Girardot, de prise en prise, les autres comédiens, tous impliqués et portant formidablement leurs rôles, le travail incroyable des techniciens, Marcel Godot en tête, dans des conditions parfois difficiles.

C’est d'autant plus émouvant qu’aujourd’hui, certains nous ont quittés. Annie, Paul Crauchet (merveilleux comédien que j'ai eu le bonheur d'avoir plusieurs fois sur les tournages de mes scénarii), Bernard Fresson...
J’ai la chance d’avoir aussi des séquences coupées au montage, car, TF1 oblige, le réalisateur dût refaire 2 épisodes à partir des 3 engrangés. Emilie enfant ne plaisait pas à la chaîne…

C’est pour France Télévision que ce film devait être fait, je le savais depuis le départ. Et c’est d’ailleurs, après bien des péripéties, et un rachat, sur France Télévision qu’il passera, quelques années plus tard.
J’avais tant attendu ce rendez-vous professionnel avec Annie Girardot.
Il fut magnifique !


1996 fut aussi l’année de ces sublimes « Chutes du Zambèze » à Chaillot.

1998. J’étais allée, avec un ami, la voir au Théâtre St Georges. Nous devions souper ensuite, juste en face le théâtre. Le plus beau spectacle fut, en fait, après la représentation. Il lui fallut 20’ pour traverser cette petite rue et nous rejoindre. Accaparée par ses admirateurs qui, bien sûr, demandaient un autographe, mais, surtout, parlaient avec elle, d’eux, de leurs enfants, lui montraient des photos (on n’était pas encore à l’époque odieuse du selfie) : « Annie, vous vous souvenez ? On était venus vous voir jouer à Montluçon, et on avait fait une photo avec notre gamin » « Ah ! mais oui, disait Annie, regardant la photo. Comment il va le petit ? Il doit être grand maintenant !»… Elle s’attardait avec plaisir, ne signait pas à la va-vite, regardait les gens dans les yeux, y cherchait de l’amour, en recevait et en donnait. C’était un spectacle saisissant, réconfortant. On comprenait ce lien vrai et fort avec « le peuple », au sens digne du mot. Elle était des leurs, elle était avec eux, de plain pied, sans calcul.
On se voyait ainsi, de temps en temps, Annie, souvent pour des soirées théâtre-souper. Je te raccompagnais rue du Foin. Tu aimais ce quartier où tu habitais depuis des décennies. Place des Vosges, puis, juste derrière, cette petite rue étroite du Foin. Ton cœur est là, à jamais. Tes amours s’y sont gravés, les jolis souvenirs et les moins beaux, le bleu du septième ciel, et les orages des périodes noires. Ta vie, tu l’as vécue à fond, avec excès, comme pour mieux te sentir vivante. C’est ce qui nous a donné une comédienne cash, qui ne jouait pas à être, mais qui était à fond le personnage. Passionnée et généreuse, tu ne t’économisais pas.
Je vais, chaque semaine, dans un atelier de peinture, pas loin, rue de Sévigné. Je passe souvent, cherchant à me garer, par la place des Vosges, par la rue du Foin. Il m’est arrivé de trouver une place juste devant ton immeuble. Comment ne pas penser à toi ?


Octobre 2002 : Dans la ville où habite ma mère, en région parisienne, Madame Marguerite est à l’affiche. Nous t’attendons à la sortie, dans le hall où une table est installée pour que tu dédicaces. Tu es stupéfaite de me voir là… Je te présente « ma petite maman » âgée. Tu la fais asseoir à tes côtés. Entre deux signatures d’autographes – la séance durera près de deux heures- tu reviendras toujours vers elle, ne la quittant pas des yeux pendant de longues minutes, lui prenant la main, parlant avec elle. Tu pensais certainement à la tienne. Ma mère, qui a 91 ans aujourd’hui, s’en souvient encore avec émotion.

Annie aimait les mères et les maisons. Les vieilles mères, qui lui rappelaient la sienne, et les maisons dans lesquelles on s’abrite, on se sent protégé, comme dans le ventre de sa mère, justement. Sa mère était sage-femme, la boucle est bouclée.
Elle aimait connaître l’histoire d’une maison, comme une généalogie, s’y balader, y humer l’atmosphère, écouter la bâtisse vivre, les bois craquer. Toujours à l’affût, à l’écoute aussi des recherches des autres, des maisons qui allaient se vendre. Prête à faire des kilomètres pour visiter une maison dont on lui avait parlé, dont l’histoire lui avait parlé, même si elle savait qu’elle ne quitterait pas la sienne. Maison-cocon, maison-refuge, maison-maman, elle qui était écartelée entre la France et l’Italie, un pied à Paris, un pied à Rome. Entre sa famille et son métier, entre Renato et ses amours parisiens. Depuis « Rocco et ses frères », elle avait, ancré en elle, un bout d’Italie. Et sur tous les plateaux, elle aimait le porter, comme un porte-bonheur, pour se sentir complète. Sur le tournage de « Une soupe aux herbes sauvages », ce fut cette perruque qu’elle s’était faite faire chez sa chapelière préférée à Rome. La perruque n’était pas vraiment du goût du réalisateur, mais il n’avait rien dit car il avait senti que cela la rassurait. Comme tous les grands comédiens, La Girardot avait besoin d’être rassurée, toujours en doute quand on avait dit « coupez ».

Octobre 2004 : Deux ans après leur première rencontre, ma mère est à Paris pour quelques jours. Je l’emmène au théâtre, puis souper au Grand Colbert, un rituel, la cantine des comédiens après le spectacle. Ce soir là, Line Renaud est attablée avec Roland Giraud, Maïke Jansen (c’était quelques jours avant la disparition de leur fille Géraldine). J’ai écrit pour Line, je l'embrasse. On commence à dîner avec ma mère, quand Annie Girardot fait son entrée, avec une joyeuse bande, revenant d’une première de comédie musicale. Annie va embrasser Line, et, ce faisant, m’aperçoit plus loin. « Ah ! Ben, alors, tout le monde est là, ce soir ! » Chaleureuse, les bras ouverts, elle vient aussitôt nous embrasser.
« Comment elle va, la maman ?.. Et toi, tu as toujours ton beau jardin ? »
Elle est restée un moment papoter avec nous, puis a rejoint ensuite sa grande tablée joyeuse. Elle était entourée et heureuse.
On nous dira plus tard qu’à cette époque, elle était déjà au pays d’Alzheimer, et oubliait tout. Pourtant…

J’aurais tant aimé, Annie, qu’on te laisse encore faire ton métier quelques temps, quelques mois, quelques années, qui sait ? Juste quelques séquences, ci et là. Car, dès qu’on disait « moteur », ton oeil s'allumait. Tu étais heureuse.
J’aurais tant aimé qu’on ne clame pas sur les journaux ta maladie, donnant le coup de frein brutal à ce qui était ta vie, simplement. Après la révélation publique, aucun médecin ne t’assurerait plus, aucun producteur ne t’engagerait, on le savait. On te tuait définitivement. Tu avais encore de belles scènes à nous offrir, l’équipe autour de toi te permettant, en aménageant texte, oreillette, technique, d’exprimer les émotions des personnages vieillissant et poignants, comme tu le fis dans le film d’Haneke ou de Jane Birkin.
On aurait tant aimé te voir encore un peu, tant aimé te parler encore un peu, tant aimé rigoler avec toi et tant pis si c’était en vrac. Mais ta porte, ton téléphone, ton accès nous furent subitement fermés. On faisait visiblement barrage à ta vie d’avant. On aurait aimé et compris que ce fût par pudeur.
Mais où est la pudeur quand on expose, à travers livres, interviews, tes difficultés ?

J’aurais tant aimé qu’on ne te fasse pas tourner ce documentaire indécent, voyeuriste, soi-disant sur l’Alzheimer, sans te le dire, te manipulant, comme une pauvre marionnette, te trompant, te faisant croire que c’était un film sur toi, comédienne, te faisant dire un texte que tu croyais de fiction - le rôle d’une patiente qui perd la mémoire, face caméra, tu étais parfaite – alors qu’il parlait de toi, à ton insu. Comme si tu faisais tes propres adieux aux spectateurs. Odieuse manipulation. Ce film a rendu beaucoup d’entre nous mal à l’aise. Oui, terrible malaise, sensation que, sous couvert de bons sentiments, on t’avait trahie. J’aurais aimé qu’on ne t’expose pas ainsi, prise au piège de ta fragilité, pour te cacher définitivement, t'exiler loin de chez toi, loin de ton univers, de tout ce qui faisait ta vie et te donnait encore l’envie de te lever. Alors, ta plongée vers l’oubli s'est accélérée, éteignant en toi cette petite flamme qui se ravivait aux mots « Ça tourne. Action».
On nous a dit qu’ensuite, tu ne te souvenais plus que tu étais Annie Girardot. Ce n’est pas grave, Annie… Nous, on s’en souvient !
-----------------------------------------------------
bientôt, sur ce blog, d'autres "séquences-vie d'une scénariste", racontant d'autres tournages, d'autres comédiens, ce métier particulier.
- un hommage à Claude Boissol vient d'y être ajouté
venez y surfer de temps en temps.
et n'hésitez pas à commenter ou poser vos questions sur "contact". j'y répondrai sur ce blog ou personnellement, selon la teneur de votre message.
-----------------------------------------------------
- Michèle R.:
J'ai adoré votre blog très vivant. Tour à tour, vos souvenirs sont émouvants, touchants, drôles et particulièrement croustillants. Le récit est très bien troussé. On a tout le temps envie de lire la suite! Faites-en un livre de souvenirs! Cela vaut le coup.
 Michèle LETELLIER
scénariste, auteur de théâtre, romancière,
comédienne... et ex-psy
Michèle LETELLIER
scénariste, auteur de théâtre, romancière,
comédienne... et ex-psy